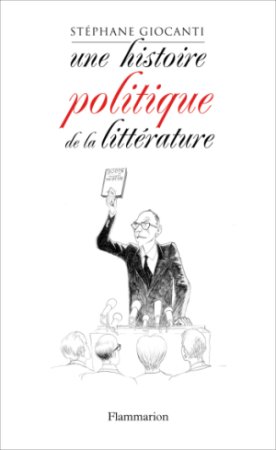 Dans quel autre pays au monde que la France littérature et politique sont-elles aussi inextricablement liées, l’une louchant constamment sur l’autre qui cherche à son tour à s’attirer les faveurs de la première pour se donner une assise et une légitimité ? Cette interrogation est le point de départ du brillant essai de Stéphane Giocanti une histoire politique de la littérature.
Dans quel autre pays au monde que la France littérature et politique sont-elles aussi inextricablement liées, l’une louchant constamment sur l’autre qui cherche à son tour à s’attirer les faveurs de la première pour se donner une assise et une légitimité ? Cette interrogation est le point de départ du brillant essai de Stéphane Giocanti une histoire politique de la littérature.
« François Ier fut roi de France et poète. Le cardinal de Richelieu institua quarante immortels pour fixer sa patrie sur un olympe littéraire. Avant d’être empereur, Napoléon rêva d’être écrivain. Le romancier Malraux fit un inoubliable ministre de la culture, pour la gloire d’un général publié lui-même dans la bibliothèque de la Pléiade… nulle part ailleurs qu’en France, politique et littérature ne forment un couple aussi singulier » lit-on sur la quatrième de couverture. Pour expliquer ce phénomène extraordinaire, Stéphane Giocanti, par ailleurs auteur de deux biographies sur T.S. Eliot et Charles Maurras, dénoue avec un grand savoir mais sans prendre de pincettes, les fils qui ont relié la politique à la littérature et font qu’aujourd’hui encore, des politiques cherchent à s’attirer le respect en publiant des livres et que quelques écrivains tentent, sans vraiment faire illusion, d’atteindre les sphères politiques.
François Ier était poète, Louis IX avait son Joinville, le roi René fit venir Villon à sa cour, Richelieu fonda l’Académie Française sous le règne de Louis XIII, cependant c’est surtout au XIXe siècle que le destin de la politique et de la littérature fut scellé par deux figures illustres : Hugo et Zola.
Le sous-titre de cet essai le confirme, de Victor Hugo à Richard Millet, c’est en littérature que s’est joué le destin de la république française et c’est elle qui a porté aussi haut ses écrivains. Après la Révolution, le Panthéon, qui était une église, fut transformé pour accueillir les hommes illustres de la nation et c’est en 1885, à la mort de Victor Hugo que l’église Sainte-Geneviève qu’il abritait disparut définitivement pour devenir la dernière demeure des grands hommes de la France. Il y a quelques semaines à peine, Nicolas Sarkozy, en proposant de panthéoniser Albert Camus, dut faire face à d’innombrables critiques provenant de tous les milieux de la culture et de la politique. Où l’on voit que la littérature demeure un des principaux faire-valoir de nos hommes politiques et que le destin des grandes figures de la littérature est loin de laisser indifférent en France.
Découpant son essai en plusieurs chapitres : les prophètes, les maudits, les plantés, les pamphlétaires… où l’on croise les noms des écrivains les plus importants des deux derniers siècles, les catégories ne s’excluant pas les unes les autres, Giocanti ne ménage pas les hommes, ceux qui se sont fourvoyés dans la collaboration, la défense du stalinisme ou qui ont chanté les louanges du grand Timonier, ceux mêmes qui ont fait profession d’accusateur public et de vrai planté au regard de l’histoire, Sartre par exemple, parfois au détriment de leur œuvre, généralement sans que ces erreurs ne portent préjudice à leur talent.
Aujourd’hui les écrivains ont pratiquement déserté la politique à l’image de Richard Millet affirmant « je ne suis rien politiquement » ou, lorsqu’ils s’engagent, c’est pour des causes humanitaires, pour une campagne présidentielle.
Quand la politique n’a plus rien de haut ni de grand à proposer, quand elle a abattu tous les sommets vers lesquels s’élever, la littérature la déserte pour s’enfermer dans sa tour d’ivoire. Nous avons encore des hommes politiques qui écrivent : Giscard d’Estaing, Villepin, Bayrou, Sarkozy, mais ce sont de piètres auteurs qui se cherchent une légitimité qu’ils peinent à trouver en politique. Cela ne demeure pas moins l’illustration que toute politique est affaire de mots.
Si la politique ne fait plus rêver personne en France, c’est certainement qu’elle a tordu le cou à tous les idéaux et du même geste en a éloigné les écrivains. Il est faux de dire que nous n’avons plus de grands écrivains en France, ils se sont simplement reclus aux marges d’une république épuisée qui n’est plus que bureaucratie. Quand les acteurs politiques perdent leur langue, qu’ils se noient dans un jargon techniciste, bureaucratique, dans un langage totalitaire dirait Bernard Noël, ils ne sont pas loin de perdre leur pouvoir.
S’il y a un enseignement à tirer de cette histoire politique de la littérature, c’est qu’on ne gouverne pas un peuple en détruisant sa langue ; on ne fait qu’anéantir son unité.
Alors on peut toujours tenter de lancer des débats sur l’unité nationale pour ne pas affronter son échec, la vraie question qui demeure est pourtant : combien de temps la politique peut-elle faire illusion avec des discours stéréotypés, formatés, sensurés, des paroles qui déjà n’ont plus de vie, parce que machinales, machinisées ?
Aucune révolution ne se fera sans commencer par la langue, aucune n’en a jamais fait l’économie car c’est par les mots que l’on façonne le monde. Se réapproprier notre langue, tant pour retrouver le sens de la littérature que celui de la politique, c’est par là qu’il faut commencer.
Stéphane Giocanti, Une histoire politique de la littérature, Flammarion, 307 pages.

Poster un Commentaire