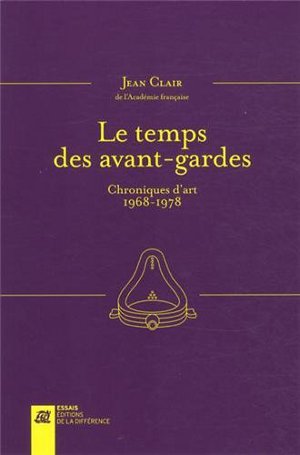 Jean Clair, écrit Colette Lambrichs, dans sa courte et néanmoins stimulante préface au Temps des avant-gardes qu’elle s’honore de publier, est « un des meilleurs écrivains qui se soient exprimés sur l’art. » Remettant les pendules à l’heure comme elle sait le faire avec une pertinence rare, Colette Lambrichs écrit ainsi au sujet de Jean Clair dont le présent livre réunit les critiques d’art rédigées pour L’art vivant et la NRF dans les années 60 et 70, « D’aucuns s’étonneront que Jean Clair ait parlé le premier de tel ou tel artiste d’avant-garde, en ces années-là, alors que certains le traitent aujourd’hui de suppôt de la réaction, comme il se doit en France dès qu’on sort du rang. C’est ne pas savoir que le « temps des avant-gardes » est révolu depuis plusieurs décennies et que ceux qui, désormais, s’en réclament en sont aussi éloignés que des révolutionnaires qui feraient partie d’un gouvernement social-démocrate. »
Jean Clair, écrit Colette Lambrichs, dans sa courte et néanmoins stimulante préface au Temps des avant-gardes qu’elle s’honore de publier, est « un des meilleurs écrivains qui se soient exprimés sur l’art. » Remettant les pendules à l’heure comme elle sait le faire avec une pertinence rare, Colette Lambrichs écrit ainsi au sujet de Jean Clair dont le présent livre réunit les critiques d’art rédigées pour L’art vivant et la NRF dans les années 60 et 70, « D’aucuns s’étonneront que Jean Clair ait parlé le premier de tel ou tel artiste d’avant-garde, en ces années-là, alors que certains le traitent aujourd’hui de suppôt de la réaction, comme il se doit en France dès qu’on sort du rang. C’est ne pas savoir que le « temps des avant-gardes » est révolu depuis plusieurs décennies et que ceux qui, désormais, s’en réclament en sont aussi éloignés que des révolutionnaires qui feraient partie d’un gouvernement social-démocrate. »
Cet « avènement de l’avant-garde », « lorsque c’est l’art qui remplace la religion », Jean Clair, après en avoir été l’un des premiers thuriféraires, en fait aujourd’hui la critique et le résume ainsi : « Je finissais par devenir sceptique puis bientôt carrément hostile à cette avant-garde vite institutionnalisée, imposée par les Etats-Unis, vendue et promue, jusqu’à n’être plus qu’une marque de fabrique, une griffe – avant de devenir, sous le nom d’ « art contemporain », un art qui est à l’oligarchie internationale et sans goût d’aujourd’hui, de New York à Moscou et de Venise à Pékin, ce qu’avait été l’art « pompier » aux yeux des amateurs fortunés de la fin du XIXe siècle. » Et d’analyser le statut de critique d’art, qu’il assume difficilement, comme concomitant à une crise de l’art. « La critique d’art comme activité singulière apparaîtrait donc à un moment où l’art commence d’être la proie de la maladie. » Et si le critique est le spécialiste chargé d’ausculter le mal qui atteint l’art (« Le mot est d’origine médicale, et se rapporterait à la krisis, le moment de l’évolution d’une maladie qui suppose une décision. Est appelée « critique » la phase d’une maladie en son moment dangereux, difficile. Est critique le médecin qui sait déceler ce moment et intervenir à bon escient dans cette évolution clinique, poser un diagnostic, influencer son pronostic au moment opportun, rappelle Jean Clair »), il lui faut donc un auspice où placer le corps malade et c’est ainsi qu’il a inventé le musée. Le musée au XIXe siècle a exposé les œuvres d’art comme autant de symptômes d’une dégénérescence ou d’une décrépitude de l’art, pour reprendre le mot de Baudelaire, comme autant de maux à ausculter et comprendre. Et d’ailleurs Baudelaire écrivait déjà qu’il rédigeait ses salons en s’appuyant sur les catalogues des œuvres plutôt que de se rendre dans les salles d’exposition, comme s’il pressentait ce qu’ont de morbide ces lieux con-sacrés à l’art où l’on rend un culte à des œuvres décontextualisées, comme dans une église mais sans la présence réelle qui fait qu’on y perçoit le vivant.
Le XIXe siècle, montre Philippe Muray dans Le XIXe siècle à travers les âges, c’est encore lui qui a transformé l’église Sainte-Geneviève en Panthéon, transformant un lieu dédié au culte religieux en un lieu dédié au culte des illustres morts. Lui aussi qui a inventé l’histoire et l’archéologie. N’est-ce pas le symptôme que l’on se sent parvenu à un stade critique, à une époque de crise, lorsque l’on se met à collectionner les traces du passé et à leur multiplier les hommages ? Si c’est le cas, nous ne sommes pas encore sortis de cette crise majeure malgré les tentatives des avant-gardes de bousculer l’ordre établi au nom du progrès et des lumières, qu’il s’agisse des impressionnistes, des fauvistes, des cubistes, des surréalistes, etc, puis de la période avant-gardiste des années 60-70 à laquelle Jean Clair s’est intéressé un des premiers. Nous n’en sommes pas sortis car ce qui se vend aujourd’hui sous le nom d’art contemporain, remarque Jean Clair, a pour seule ambition d’entrer au musée où il pense trouver sa légitimité, alors qu’il n’y trouve que le mausolée fait pour accueillir sa dépouille mort-née.
« Quel artiste dit d’avant-garde, dans les années 10-20, n’avait prétendu échapper au musée et si possible, le détruire ? Aujourd’hui il n’y a pas de plus grand rêve pour un « artiste contemporain » que d’entrer dans ce musée qu’il révère avec la mine contrite et réjouie d’un roturier admis dans la noblesse. Retournement de sens, inversion du système qui montre à quel point le musée a renié ses idéaux d’origine. Il faut donc que le musée aujourd’hui soit détruit pour les raisons mêmes avec lesquelles on défendait hier son existence. »[1]
En effet, à quoi servent les musées aujourd’hui ? Cette question traverse toute l’œuvre critique de Jean Clair, des articles recueillis dans cet ouvrage à Malaise dans les musées et L’hiver de la culture récemment publiés. D’une part, on prélève les œuvres de leur contexte originel pour les placer dans les musées, leur ôtant toute fonction décorative, illustrative, leur faisant perdre leur sens[2], d’autre part, à force d’être exposées aux regards, ces œuvres s’abîment[3]. Le musée, c’est en quelque sorte le cimetière des œuvres, l’endroit où on les place une fois leur temps passé. Alors, que les « productions artistiques » de Jeff Koons, Damien Hirst ou Murakami soient exposées dans des musées signifie suffisamment qu’elles sont toujours déjà mortes et n’existent que comme traces non pas d’un passé mais de l’illusion d’une époque. D’une époque virtuelle, spéculative, qui n’a donc rien à voir avec la réalité sensible. Les musées sont ainsi devenus les lieux de mort de la création et s’ils sont si visités aujourd’hui (du moins certains d’entre eux), c’est qu’ils donnent à voir les restes de ce qui est passé d’une part et apparaissent comme les nouveaux lieux de culte où venir rendre ses dévotions d’autre part, dans une société de consommation où l’on se dit qu’il est plus intelligent de consommer de l’art et de la culture qu’autre chose, parce qu’il y a aujourd’hui une certaine pression sociale, un rien snobinarde, à avoir vu les grandes expos à la mode et qu’il faut absolument tuer le temps le samedi pour ne pas sombrer dans la folie destructrice que fait naître l’absence de travail, comme dit Thomas Bernhard.
L’œil, dans son numéro de janvier, décomptait alors pas moins de 21 expositions autour de l’impressionnisme dans le monde, dont la majorité en Europe et en Amérique du Nord, et s’interrogeait : les expositions autour de l’impressionnisme, dont on sait qu’elles fonctionnent très bien, ne sont-elles que des machines à sou ? Non, bien sûr, répondent les spécialistes car chaque nouvelle exposition apporte un éclairage nouveau sur un aspect de l’impressionnisme. Fort bien, mais dans le fond tout cela est simple affaire de spécialistes. Comment se fait-il que le grand public s’y rue à chaque fois ? Est-il si passionné par les découvertes sur la manière dont Monet traitait l’habillement, sur les rapports de l’impressionnisme à la politique, à l’écologie, à l’économie ? On peut en douter.
« Et l’on admet enfin que le bénéfice intellectuel et spirituel de ces pèlerinages est à peu près nul : cette agitation n’est que le produit d’une idolâtrie repoussante et finalement dangereuse, écrit Jean Clair ».
Car que retirent ces grappes d’adolescents avachis, les écouteurs vissés dans les oreilles, qu’on trimbale à longueur de journée au musée d’Orsay ? Que retirent les masses agglutinées qui défilent devant les grandes expositions en mangeant du pop corn et en braillant dans toutes les langues de Babel ? Rien, elles tuent le temps simplement et la société préfère qu’elle le tue ainsi que dans la violence. Mais l’art dans tout ça ? L’art vivant ? Où est-il passé ? On révère des artistes morts depuis longtemps ou des spéculateurs qui se disent artistes parce qu’ils vendent leurs « œuvres » à des prix exorbitants, alors qu’ils ne nous apprennent rien d’autre sur notre époque que ce que nous savons déjà : elle éprouve autant de haine que d’envie pour les riches parvenus qui sont ses icônes.
Toute forme de sacralisation est dangereuse en ce qu’elle fait naître des tabous, des interdits et des rituels collectifs qui placent sous le coup de la violence populaire ceux qui la refusent. Or, il y a une sacralisation de l’art contemporain et celui qui le critique se place de facto hors de la cité, prêtant le flanc à toutes sortes de violences. Mais dans le même temps les icônes de l’art contemporain sont constamment menacées de succomber à la vindicte populaire, de déchoir violemment de leur piédestal. Parce que, dans le fond, l’homme de la rue sent bien ce qu’a de factice cette prétention à dominer.
« Le XIXe siècle a vécu sur un mythe : que l’artiste soit à la rue et son œuvre au musée (une fois bien sûr l’artiste mort, d’avoir été trop longtemps à la rue sans doute). Il est temps maintenant que l’œuvre soit à la rue, et l’artiste logé au musée… » Aujourd’hui les œuvres des « artistes » reconnus et célébrés sont dans les musées, ils ne méritent pas même la critique.
Qui aurait l’outrecuidance de critiquer Monet, Rodin, Picasso ou Jeff Koons ? Les uns sont morts depuis longtemps et passés à la postérité ; l’autre est l’image même du néant, de l’inversion de la vie, or on ne critique pas le néant, on ne peut qu’en faire le constat. Les artistes auxquels demeure une certaine conscience de ce qu’entraîne la mise au musée doivent redouter que leurs œuvres y entrent car ils savent qu’entrer au musée, c’est entrer dans l’histoire donc dans le passé. Mais ils ne trouvent pas leur place car l’idolâtrie des grandes figures la tient toute.
Il n’est plus question de crise, les grands musées ont tout absorbé, rendant la création vivante quasiment impossible ou seulement comme un rappel, un pastiche des œuvres qu’ils conservent. Sans crise, il n’est plus besoin de critique. Aux journalistes, on ne demande plus que de faire la promotion des expositions et à ceux qui, comme Jean Clair, s’intéressent à l’art et en déplorent la pauvreté, on demande de se taire.
Voici peut-être venu le temps où l’on doit fermer la porte ouverte au XIXe siècle et où le critique, n’ayant plus rien à critiquer, doit se taire en souhaitant qu’un nouvel art naisse, loin de l’académisme, loin des institutions culturelles et de ses subventions, loin de la spéculation, loin de toute forme d’idolâtrie.
Tout reste à faire et à inventer, c’est le sens de la vie. « Instituer, pour mettre un terme à l’idolâtrie du culturel, une sorte d’économie de l’image iconale et de la vénération qu’elle demande. Le critique n’a plus rien à faire dans cet office. »
Jean Clair, Le temps des avant-gardes, 315 pages, éditions de la Différence.
[1] « Je savoure le fait d’être exposé au Louvre de mon vivant ! » a confié Enki Bilal au magazine L’œil (numéro de février 2013). Rappelons que le premier artiste à être entré au Louvre de son vivant, Félix Ziem n’est pas ce que l’on pourrait appeler un peintre avant-gardiste. Bon peintre et bon coloriste, sa peinture un rien académique, faisait écrire à Huysmans : « Qui a vu l’un des tableaux de ce coloriste, les connaît tous. »
[2] Ce qui a longtemps été un sujet de discorde entre le Musée du Louvre et le Château de Versailles et qui le demeure en partie (cf. L’œil, fév. 2013)
[3] Et l’on est contraint, pour les préserver, de les recopier, comme c’est le cas de Lascaux 2 ou de faire subir aux visiteurs un « nettoyage » avant de pénétrer en certains lieux comme la chapelle Sixtine (cf. L’œil, fév. 2013)

merci pour cette critique et ce point de vue qui fait du bien sur l’art. Les questions mises en avant sont bien légitimes et l’on est en droit de se demander qui fait loi dans les musées.
En attendant, il reste les foires, les rencontres, les tentatives. 🙂