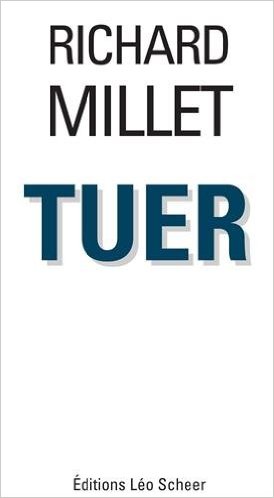 Richard Millet est l’auteur de quelque quatre-vingts livres : romans, récits, essais … qui font de lui, pour ceux qui savent lire, l’un des plus grands écrivains de langue française vivants.
Richard Millet est l’auteur de quelque quatre-vingts livres : romans, récits, essais … qui font de lui, pour ceux qui savent lire, l’un des plus grands écrivains de langue française vivants.
Membre du comité de lecture des éditions Gallimard à qui il rapporta deux prix Goncourt, il en fut chassé en 2012 à la suite d’une cabale menée contre lui par la courageuse Annie Ernaux et sa cohorte d’écrivains sans nom, partis combattre le « pamphlétaire fasciste » à cent-vingt contre un.
Il a repris depuis quelques mois la direction de La Revue Littéraire, publiée chez Léo Scheer.
Un ouvrage collectif, Lire Richard Millet, vient de lui être consacré aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Il est, cette rentrée, l’auteur de deux livres.
Matthieu Falcone : Vous venez de publier deux récits, Tuer et Israël depuis Beaufort. On ne peut pas dire que la presse se soit précipitée pour en rendre compte. A quoi attribuez-vous ce quasi silence (même s’il faut relever quelques bons articles), quand il n’est pas remplacé par des articles haineux ? A leur propos dérangeant : la guerre, Israël, le catholicisme ? A la disgrâce dans laquelle vous tient la presse et une bonne partie du monde littéraire, l’ouvrage collectif qui vous est consacré aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, apportant néanmoins la preuve que vous avez de vrais lecteurs et une œuvre reconnue ?
Richard Millet : La presse officielle a décidé depuis trois ans de ne plus me faire de publicité même en m’attaquant. C’est le cordon sanitaire. Il arrive que j’aie quelques articles dans Valeurs Actuelles mais c’est à peu près tout. Même les articles haineux, et il y en a eu un, sont considérés comme du pain béni pour beaucoup d’écrivains aujourd’hui, puisque c’est le seul moyen qu’ils aient de faire parler un peu d’eux. Mais à partir du moment où l’on sait qu’on n’aura rien, la situation est extrêmement claire et simple. Il reste cependant les réseaux souterrains comme les sites internet pour permettre de faire circuler les informations et les opinions sur les livres. Autrement dit, la presse dite littéraire est aujourd’hui si corrompue qu’elle n’est plus qu’un support publicitaire, donc avoir un article ou pas ne sert absolument à rien, car la presse ne fait plus vendre. Il suffit de regarder cette rentrée littéraire : rien ne se vend. Nous atteignons le degré zéro de ce qu’on peut appeler la littérature en France.
M.F. : Vous aviez tout de même eu droit à quelques articles pour vos précédents ouvrages, je pense notamment au Dictionnaire amoureux de la Méditerranée.
R.M. : Très peu. Deux ou trois articles, mais pas dans la grande presse officielle. Je fais partie, avec Renaud Camus et quelques autres, des gens blacklistés comme on dit en Bretagne. Mais c’est un silence auquel on s’habitue et qui ne me gêne absolument pas. Je suis en guerre, il est donc normal que l’on me réponde par le silence, qui est une arme intéressante dans cette situation.
M.F. : A ce sujet, vous avez écrit Tuer, qui apporte un éclairage nouveau sur la guerre que vous avez menée au Liban en 1975 et dont, jusqu’alors, vous n’aviez parlé qu’à travers la fiction. Vous y écrivez, « Pascal Bugeaud n’est pas, selon la formule consacrée, mon « double » romanesque : c’est moi qui parle. » Pourquoi revenir sur cette guerre qui occupe, il est vrai, une place importante dans votre œuvre et, vous l’écrivez, dans votre vie ?
R.M. : C’est un livre que j’ai écrit d’un seul coup après une discussion avec Léo Scheer et Angie David. J’ai écrit ce livre en un mois et demi, à partir du mois d’avril 2015, quarante ans après le début de la guerre au Liban qui commença le 13 avril 1975. Quarante ans, ce n’est pas rien. C’est presque toute une vie d’adulte. Je me suis aperçu que le temps avait considérablement modifié l’approche de ces choses. J’ai également entendu beaucoup de saloperies sur cette guerre dont on a rendu responsable les phalanges. C’est ce qu’on lisait encore dans la presse de gauche en avril 2015. Quarante ans après, on lisait encore les mêmes choses, les mêmes déformations sur l’origine de cette guerre. C’est une des raisons qui m’a poussé à écrire, l’autre étant le problème de mon rapport au temps. Il est toujours extrêmement angoissant de constater que les choses s’éloignent ainsi dans le temps. En regardant des photos des combattants de cette époque, je me suis dit : « que c’est vieux ! ». L’allure des gens, leurs vêtements, même leur matériel est très vieux. Nous sommes dans l’histoire et j’en parle à des gens comme vous qui n’étiez même pas nés à cette époque. Cela pose beaucoup de questions à un écrivain et à un homme. C’est ce qui m’a donné envie de revenir là-dessus. Il y a aussi et surtout la question de donner la mort qui me hante depuis toujours. J’en ai déjà parlé dans La Confession négative mais j’en parle ici avec un autre éclairage, en racontant un épisode que je n’avais pas raconté. Que devient un épisode aussi traumatisant, aussi fondateur, quarante ans après ? Comment un tel épisode peut cheminer en vous et en accompagnement du mort pendant toute votre vie ? J’ai essayé de méditer là-dessus. Il s’agit d’ailleurs plus d’une réflexion que d’un récit, même s’il y a un élément de récit.
M.F. : Vous écrivez aussi : « J’écrirais pour être entendu, pour tenter de mettre fin à cette négation de soi que suscite le fait de n’être pas cru, dût-il y avoir entre ma bouche et l’oreille du lecteur, l’empan d’une vie d’écrivain. » Croyez-vous avoir été entendu et cru ? Que cela soit possible ?
R.M. : Je ne dis pas cela en pensant être entendu de mon vivant, car je sais bien qu’aujourd’hui, ce genre de choses est extrêmement difficile à comprendre. Mais je ne renonce pas à être entendu plus tard. Quand vous n’avez plus de presse, ni rien, vous travaillez pour un autre type de temporalité. Vous n’écrivez pas pour la postérité selon la formule consacrée, mais pour qu’un jour, peut-être, vous soyez lu et que cette lecture modifie la perception des choses. Un jour, le politiquement correct commencera à se lézarder, il sera alors possible de lire ce texte.
Toute une vie d’homme, oui, parce que l’on écrit forcément pour être lu et entendu, mais en même temps, c’est une position extrêmement ambiguë car il y a quelque chose qui est presque de l’ordre de l’anonymat dans la démarche de l’écrivain, l’auteur s’effaçant nécessairement à partir du moment où il écrit et publie. J’ai donc voulu essayer de rattraper ce que je suis avant que ça ne s’éloigne trop dans le temps. Il m’est égal d’être cru. Entendu, je pense l’être un peu.
M.F. : « Tuer relève moins du secret que du fond ténébreux de la vérité », écrivez-vous. Si j’ai bien compris, vous vous êtes engagé dans la guerre au côté des chrétiens libanais pour plusieurs raisons. Parce que vous ne supportiez pas que la presse occidentale déshonore des gens (les chrétiens libanais) qui avaient été si intimement mêlés à votre enfance que vous pouviez vous dire l’un des leurs. Parce que vous voyiez la guerre comme un moyen d’accéder à l’écriture et de fuir la maladie qui vous murait en vous-même – une maladie que vous évoquez dans votre Journal que publie La Revue Littéraire – et parce qu’écrire vous semblait l’unique chemin vers la vérité. La guerre, comme l’écriture, sont-elles liées à la vérité et à l’innocence ?
R.M. : C’est une question compliquée. Je ne veux pas tomber dans le cliché selon lequel la guerre révèle l’être humain lui-même, et son fond ténébreux. L’être humain n’a pas besoin de ça pour se révéler ce qu’il est, mais il est vrai que la guerre est une sorte d’accélérateur. C’est ce qui est absolument passionnant, si l’on peut dire que la guerre est passionnante. C’est pourtant ce qui fut le cas, et c’est ce qui est sans doute encore plus difficile à expliquer que le fait de tuer : il y avait à cette époque une sorte de joie de la guerre. A ses débuts, la guerre civile libanaise était quelque chose d’assez joyeux. Entendons-nous : il y avait aussi des moments terrifiants. Le rapport à la vérité naît de l’accélération des êtres et des gestes qui produisent une accélération de la pensée. Toute accélération de la pensée – on peut même parler de précipitation de la pensée – relève de l’éclair, or l’éclair révèle, et ce qu’il révèle est une forme de vérité. C’est ce qui m’apparut quarante ans après et qui ne m’apparaissait pas tout à fait lorsque j’ai écrit La Confession négative qui parle à peu près de la même chose mais qui souhaitait rendre compte de la totalité d’une expérience, tandis que Tuer évoque une toute petite partie de cette expérience. Cette vérité, ce que révèle cette accélération, cet éclair, demeure obscur. Il y a toujours ce fond ténébreux que l’on n’arrive pas à percer. Des choses de soi-même que l’on n’arrive pas à comprendre jusqu’au bout. Il y a ce constat que pour tuer, on peut arriver très facilement à une espèce d’indifférence envers celui qu’on tue, qui est probablement la chose la plus difficile, la plus impossible à expliquer : comment accéder à ce degré d’indifférence qui fait que l’on n’a ni joie ni pitié ; que l’on accomplit seulement un geste ? C’est le rapport que j’avais eu aux animaux dans mon enfance qui m’a permis de faire à peu près la même chose sur un Palestinien qui avait été blessé. Il ne faut jamais oublier que cette action est décomposée dans l’écriture, mais que la réalité fut beaucoup plus brève. Il ne faut pas non plus oublier que si ce n’était pas moi qui l’avais tué, c’est probablement lui qui m’aurait tué, même si notre rapport, à un moment, fut extrêmement ambigu. On peut croire en lisant le texte que nous sommes tous deux dans une chambre en train de discuter, que nous aurions presque une clope au bec, mais en réalité, la situation était extrêmement dangereuse, parce que toute forme de relâchement ou de sentimentalisme peut faire basculer de l’autre côté.
M.F. : « Tuer fait partie d’une poétique que seuls comprennent ceux qui ont combattu ou dont la jeunesse se confond avec la guerre et qui donnent à leurs enfants le regret de n’avoir pas combattu. » Jadis, comme nous le rappelle Quignard, la chasse ou la guerre faisaient naître les récits chez les hommes qui en revenaient. En ce sens, L’Iliade et L’Odyssée sont les récits fondateurs de notre littérature. Ainsi, nous serions sortis de l’Histoire en abandonnant la possibilité de ces récits et la guerre. De même, l’abandon du style, qui partage, nous rappelez-vous, sa racine avec le stylet, la lame, est sans doute lié au refus de la guerre.
R.M. : Oui, bien sûr.
M.F. : Vous écrivez aussi « la guerre, comme l’écriture, était un moyen de ne pas mourir. » Sommes-nous morts ?
R.M. : D’un point de vue civilisationnel, je pense qu’en effet nous sommes complètement morts. Sur le plan littéraire, nous sommes à l’agonie. Dire tout cela suppose néanmoins des exceptions existantes, virtuelles ou futures. On me reproche constamment de dire que tout est mort. Oui, le système littéraire français est mort, sachant que ce système littéraire français n’était pas anodin, mais constitutif de la nation française même. Ce système continue d’ailleurs de se penser ainsi et il a tort. La perte du sens, ou la fatigue du sens, comme je l’ai écrit, est concomitante de la fatigue du roman et c’est ce contre quoi j’essaie d’alerter depuis plus de quinze ans et qu’on ne veut absolument pas entendre. Quand je dis on, c’est le système, le système étant un système de falsification qui consiste à faire croire que tout va bien, que la machine éditoriale se porte à merveille puisque 500 ou 600 romans sont publiés à la rentrée. Nous sommes dans le règne de la quantité qui n’est pas le règne de la littérature. La guerre est aujourd’hui une des choses les plus gommées qui soient avec le corps mort. On ne voit plus de cadavre, ni de guerre. On nous parle de la guerre tous les jours mais on ne nous montre rien, ce qui est un paradoxe intenable. Nous avons l’impression que ce sont des guerres sans nom, des guerres propres avec quelques dommages collatéraux. Les Américains bombardent un hôpital de Médecins Sans Frontières, cela fait quelques minutes aux actus et c’est désormais cela la guerre. On ne voit quasiment pas d’images, ce qui est extrêmement regrettable parce que cela efface le grand référent à la guerre. De même, il n’y a plus de grand film de guerre, le dernier étant La Ligne rouge de Malick qui doit remonter à quinze ou vingt ans. Où est-elle la guerre ? Dans quelques documentaires ? Les Américains en ont fait sur l’Afghanistan. Brian De Palma a aussi fait un pseudo documentaire sur l’Irak. Les Danois ont fait un très bon film documentaire qui s’appelle Armadillo, sur un petit poste de soldats au milieu d’une plaine afghane, qui donne l’impression d’être en plein Désert des Tartares. Les Français, comme d’habitude, n’ont rien fait. Le rapport des Français à leur armée, qui est pourtant l’une des plus actives, ne laisse aucune trace. En France, nous sommes complètement sortis du sens historique, national et littéraire, en l’absence de ces grands récits. Il n’y a plus rien qui donne du sens, ce qui est, à mon avis, l’explication de la grande dépression française. La question de la valeur est tombée dans un trou avec celle du sens. Les valeurs ont été remplacées par des totems que sont la démocratie, l’antiracisme, la tolérance et le vivre-ensemble. Les écrivains ne vont plus s’affronter à ce réel-là et se contentent de réalité de substitution et, partant de là, nous avons de la fausse monnaie littéraire.
(à suivre)

Poster un Commentaire