Une des plus exaspérantes contradictions de nos existences réside dans le fait que nous cherchons souvent à tuer le temps, à oublier sa course inexorable, avant que celui-ci ne se charge, une fois pour toutes, de l’opération.
De bonnes lectures sont vivement conseillées pour combler ces moments perdus ou volés au tic-tac de nos vies, d’autant que celles-ci nous offrent souvent de sublimer notre vécu, en multipliant nos expériences jusqu’à centupler parfois nos révélations, le tout sagement assis dans notre fauteuil préféré. Il y a plus indécent. Aussi la littérature, bonne fille, a-t-elle souvent abordé ces thèmes de la fuite des jours et de l’angoisse du néant, variant les angles d’attaque et les approches au gré des talents et des situations envisagées.
Quelques exemples au débotté pour caresser les longues soirées d’hiver dans le sens du poêle.
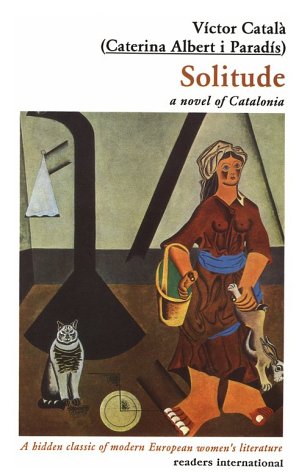
Solitude, le titre parle de lui-même, de Victor Català, nom de plume sous lequel se cachait Caterina Albert i Paradis. Montagnes et pâturages, le meilleur Giono souffle sur ces pages gorgées de sauvage poésie : « sous ce ciel d’un bleu très pur d’yeux de vierge, le coteau, nuancé de verts printaniers, couvert de maisonnettes blondes et ceint du ruban de gaze de la plaine rosée, ressemblait plutôt à une féérie de peintre impressionniste qu’à quelque chose de réel, de véritable » ou, en plus mystique, nous sommes en Catalogne que diable !: « hissé au-dessus d’une mer de têtes, immobile au milieu des petites colonnes salomoniques de sa cage dorée, le cou trop mince ployant sous le poids de la mitre, la crosse épiscopale en main, saint Ponç, de ses deux doigts crispés, envoyait aux multitudes dolentes le salut de son éternelle bénédiction ».
Et ce dernier cri : « le venin de la solitude s’était cristallisé dans son destin » qui crucifie Mila dans le monde des Lutines et des légendes, Paradis et enfer à sa porte. La magie est là, dans sa simplicité, mise à nue, et si ces lignes vous accueillent la serpe à la main, leur cœur est grand ouvert sur l’infini. L’aïoli et les escargots à la mode catalane, poussés au coude levé, feront le reste.
Pour comprendre pour de bon les raffinements de l’isolement, une affectation au Fort Bastiani s’impose. Le désert des Tartares (Dino Buzzati) se lit et se regarde, double jubilation, Valerio Zurlini ayant rendu sublimes les paysages décorant ses pages comme autant de mirages guettant les caravanes giflées de sable. Quel grand malheur que la citadelle de Bam, située sur l’antique route de la soie, n’ait pas survécu au tremblement de terre de 2003… Comme dans chacun de ses rôles, Jacques Perrin y est époustouflant : « Drogo ignorait ce qu’était le temps ». La fatalité saura lui enseigner au travers d’un espoir secret si souvent déçu, l’arrivée de l’armée du Nord, jusqu’à épuiser ses dernières forces et consumer des illusions nées de trente années à sonder le néant. Que voulez-vous, « il faut bien trouver une sorte de dérivatif, il faut bien espérer quelque chose ».
Les princes de la Cuite…
En matière de pis-aller, de passe-temps dominical, Raoul Duke et le Docteur Gonzo ne craignent rien ni personne. Keith Moon, lui-même, n’aurait pas longtemps rivalisé avec ces cobayes de papier des paradis artificiels. Ether, nitrite d’amyle et adénochrome, à doses certifiées mammouth, dégoulinent de Las Vegas Parano (Hunter S. Thompson), autre œuvre qui se regarde sur écran (Johnny Depp y trouve un nouveau terrain de jeu à sa démesure) aussi plat que l’électroencéphalogramme de ses deux héros, tant que l’envie de taquiner des herbes inconnues en Provence ne vous prend pas.
Je confesse volontiers une grande tendresse, confinant à une respectueuse dévotion, pour les princes de la Cuite, avec mention spéciale aux deux Irlandais de service, les regrettés et immenses Peter O’Toole et Richard Harris, qui surent toujours alcooliser leur cabotinage et enivrer leurs pitreries. Potaches qui tachent, certes, mais quelle classe, quel merveilleux humour s’échappaient de leurs brumes alcoolisées !
Par contre, disons-le tout net, côté acides, je suis plus basique, direct poubelles, une aspirine et au lit (avec ou sans camisole, suivant les symptômes). Le road-trip stupéfiant réserve cependant d’amusantes surprises, surtout si votre timidité naturelle vous détourne d’évènements aussi huppés que le congrès national des procureurs. Voir des reptiles antédiluviens un peu partout désinhibe son bonhomme, il n’y a pas de lézard.
De la mescaline au mescal, il n’y a qu’un pas et plus de goulot que de boulot.
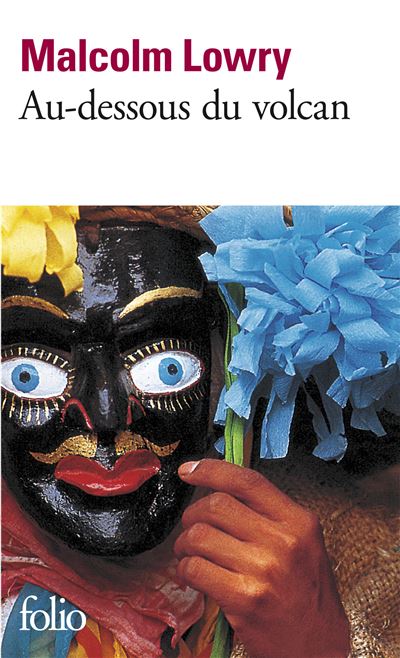
Au-dessous du volcan (Malcom Lowry), découvert, comme tant d’autres, grâce à l’infatigable travail de Juan Asensio (consulter séance tenante son magnifique blog Stalker), est un livre oppressant, envoûtant, addictif même, certainement mystique, dans lequel la sagesse de l’ivrogne se déclare : « on m’a dit que la Terre tourne, alors j’attends que la maison passe par ici ». Le Consul, « saoul-de-sang-froid-sans-inhibition », recherche la connaissance, l’amour aussi, dans l’alcool et la Tequila, relevée au piment Habanero, précipitera finalement sa chute, véritable saut de l’ange vers la dernier secret. C’est du brutal mais il n’y a pas que des Polonaises qui en boivent jusqu’à la dernière goutte dès le petit-déjeuner !
A côté de ces libations débridées mais spirituelles, la cérémonie du thé, hantant les pages de Yasunari Kawabata et de sa mystérieuse Nuée d’oiseaux blancs, apparaît tiédasse, trop compassée, conventionnelle avec son rituel d’un autre âge. Les délices du Japon, des traditions éclaboussent pourtant ses lecteurs, si d’aucuns le considèrent moins brillant que Mishima ou que Tanizaki (cela se discute pour le second). On ne juge pas les fantômes qui glissent entre passé et présent et, après tout, chacun est libre de la direction à donner à sa vie.
Un souvenir glorieux, un ancêtre dévoué sauvant la vie de l’empereur d’Autriche à Solférino, s’avère parfois aussi corrosif que le snif de cocaïne dès potron-minet ou le biberonnage d’alcool officinal. La Marche de Radetzky (Joseph Roth) ne renvoie pas seulement à la valse concluant le concert du Nouvel-An de Vienne, mais signe, avant tout, un terrible requiem sur la fin des Habsbourg. Les générations se succèdent, les traditions se prennent les pieds dans le tapis, les mœurs évoluent.
Tout passe, tout change, les secondes s’égrènent tandis que les grains de sable s’échappent inexorablement du sablier pour venir grossir les rangs des instants manqués. Voilà une première certitude qui justifie, je vous l’accorde, de tremper parfois ses lèvres dans du sévère. Une seconde, qui vaudra conclusion, ne doit-on pas toujours finir sur une note optimiste, montrer le petit coin de ciel bleu jouant des coudes au milieu des nuages noirs ? de bons livres – il y en a tant – seront toujours de joyeux et merveilleux compagnons.
François Jonquères

Poster un Commentaire