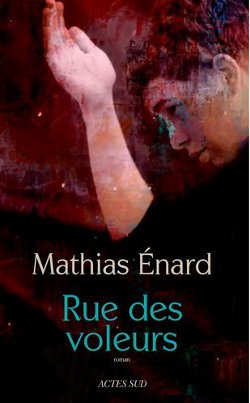 Rue des voleurs est un « roman à vif et sur le vif », nous apprennent les éditeurs sur la quatrième de couverture du livre de Mathias Enard.
Rue des voleurs est un « roman à vif et sur le vif », nous apprennent les éditeurs sur la quatrième de couverture du livre de Mathias Enard.
Un roman traitant du « Printemps arabe » et des « révoltes indignées » ? Voilà qui est un sujet actuel, brûlant comme on dit. Mathias Enard connaît le monde arabe et la Catalogne, il connaît la poésie arabe et le coran, il comprend les aspirations de la jeunesse arabe ou espagnole. Bien. Cela ne suffit pas pourtant à satisfaire le lecteur qui fermera ce roman en restant sur sa faim ou avec un drôle de sentiment d’indigestion, selon ce qu’il est capable d’avaler et de digérer. Comme les révolutions arabes dont il nous parle dans ce roman, comme le mouvement des Indignés espagnols, le roman de Mathias Enard semble dépourvu de sens, c’est-à-dire de critique qui ne soit pas la tarte à la crème des poncifs sur ces sujets.
« Aujourd’hui, une guerre terrifiante se poursuit en Syrie ; la campagne présidentielle française a atteint des sommets de xénophobie et de bêtise, la crise économique jette l’Europe du Sud dans la violence et la tentation du fascisme.
Tout cela m’est apparu comme différents visages d’un même combat en cours, le combat pour la liberté, pour le droit à une existence digne, qu’il se livre en Tunisie, en Egypte, en Espagne ou en France, écrit Mathias Enard pour présenter son roman. »
Ainsi donc, si nous suivons sa démonstration, la France et l’Espagne sont fascinées par le fascisme, par la dictature meurtrière tandis que les jeunes arabes n’aspirent qu’à la liberté et à une vie digne dont ils ont été privés. Privés par qui ? Par ces mêmes Français et Espagnols qui aimeraient tant se laisser tenter par le fascisme, j’imagine.
La première partie de Rue des voleurs est pourtant intéressante : chassé de chez lui Lakhdar erre de longs mois au Maroc en vivant comme un clochard avant d’être recueilli par le Cheikh Nouredine qui, largement financé par de richissimes princes du Golfe, dirige un Groupe pour la Diffusion de la Pensée coranique très actif. Peu à peu, Lakhdar, qui ne souhaite rien d’autre que faire l’amour à de jolies filles et lire des romans de série noire, prend conscience du prosélytisme extrêmement actif et violent du groupe sous l’impulsion du Cheikh qui enrôle de jeunes hommes perdus et un peu simples pour leur faire passer à tabac les mécréants. Puis ils disparaissent sans laisser de traces peu avant un sanglant attentat à Marrakech. Lakdhar se demande s’ils en sont responsables avant de se laisse une fois de plus traîner par la vie, par le Destin. Il vit une intense histoire d’amour avec Judit, une espagnole éprise de culture arabe et de grandes causes comme le mouvement des Indignés.
Lakhdar, comme Judit, se laissent porter par la vie et quoi qu’ils tentent de faire, semble-t-il, n’ont aucune chance de résister à leur destin. En réalité, les seuls personnages qui mènent leur destinée dans ce roman sont du mauvais côté. Il s’agit soit d’extrémistes islamistes, soit d’européens, français ou espagnols, fascisants, qui n’ont qu’un seul désir : briser la jeunesse qui aimerait se laisser porter par la vague. On dirait que personne ne comprend ce qui lui arrive. D’un côté, de jeunes gens aimeraient simplement kifer la vie sans autre but, d’un autre les fascisants français et espagnols les en empêchent sans trop de raison, si ce n’est leur fantasme fasciste. Nous avons ainsi droit à tout ce que l’opinion commune véhicule de facile sur la peur de l’immigration en Europe et la simple aspiration à la liberté dans le monde arabe. La vie n’a pas de sens, l’histoire n’a pas de sens, Dieu est absent, le mal est horrible mais ne s’explique jamais, les êtres, comme des comètes traversent le ciel en flambant sans trajectoire apparente, régies par nulle loi. Cela fait penser au monologue de Macbeth selon lequel la vie est « un conte plein de bruit et de fureur, dit par un idiot et qui ne signifie rien ». Macbeth, c’est la tentation du nihilisme, Rue des voleurs aussi, seulement, là où Shakespeare introduit une pensée critique, complexe, intelligente, Mathias Enard semble conclure qu’il n’y a pas de leçon à tirer de la vie, que c’est toujours la faute aux autres ou à Dieu qui n’est pas là et que de toutes façons les hommes ne sont que des chiens. Quel regard critique, quelle distanciation introduit-il par rapport à ses personnages ? Aucun sinon l’injustice ou l’absence de Dieu, prétexte facile et qui permet de dédouaner l’humain à bon compte.
« Je suis ce que j’ai lu, je suis ce que j’ai vu, j’ai en moi autant d’arabe que d’espagnol et de français, je me suis multiplié dans ces miroirs jusqu’à me perdre ou me construire, image fragile, image en mouvement. No se puede vivir sin amar, disais-je à Judit, et je me trompais, on peut vivre sans aimer… »
La jeunesse dans le roman de Mathias Enard est telle : elle absorbe ce qu’elle trouve, prenant de-ci de-là, sans choisir, sans critiquer, c’est-à-dire sans chercher aucun sens à rien de ce qu’elle fait, comme si les humains n’étaient plus que des bêtes qui ne savent pas ce qu’elles font, qui ne se le demandent jamais. Comment pourraient-elles encore aimer puisque l’amour demande un engagement, un choix, une connaissance de soi et de l’autre ? Or, en fin de compte le seul qui sache aimer est Lakhdar. Judit en est incapable, rongée par la perte de son identité, par une vie dépouillée de sens, à l’image de Barcelone, à l’image du mouvement des Indignés dont elle finit par se lasser, le trouvant un peu vide et sombrant dans la tristesse. L’espoir, pour la jeunesse européenne totalement perdue, viendrait-il de la jeunesse arabe, pleine d’énergie ? C’est ce que semble nous dire l’auteur, cependant le personnage de Lakhdar aussi hédoniste et perdu que les jeunes Européens n’est pas très convainquant dans le rôle de sauveur de l’Europe.
Au final, quel est le sens de ce roman ? On peut se le demander et être tenté de répondre que Mathias Enard fait partie de ces auteurs de l’insignifiance post-historique dont parle Richard Millet, un auteur dont l’écriture, comme la pensée, dépourvues de caractère propre, de la moindre personnalité, sont interchangeables à l’infini, perdus au milieu du nombre qui pense de conserve et écrit de conserve dans cette langue désincarnée qui leur permet de signer tous un même texte produit par Annie Ernaux ou un autre, peu importe, puisque leur pensée est commune et que leur écriture l’est tout autant.
Mathias Enard, Rue des voleurs, Actes Sud, 252 pages

Poster un Commentaire