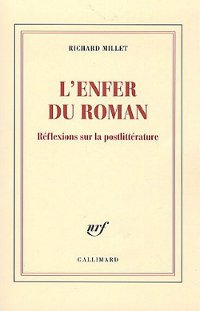 Richard Millet est entré en guerre à vingt ans. Il semble n’avoir jamais déposé les armes depuis. Si ce n’est plus avec un fusil d’assaut qu’il se bat, il n’en est pas moins demeuré le franc-tireur de sa jeunesse libanaise, combattant désormais un monde moins violent physiquement mais non moins hostile, celui du Nouvel Ordre moral comme il l’appelle, qui étend sa domination par la culture de masse.
Richard Millet est entré en guerre à vingt ans. Il semble n’avoir jamais déposé les armes depuis. Si ce n’est plus avec un fusil d’assaut qu’il se bat, il n’en est pas moins demeuré le franc-tireur de sa jeunesse libanaise, combattant désormais un monde moins violent physiquement mais non moins hostile, celui du Nouvel Ordre moral comme il l’appelle, qui étend sa domination par la culture de masse.
Dans L’enfer du roman, sous-titré Réflexions sur la postlittérature, il dispense 555 réflexions comme autant de coups bien portés au roman actuel qui étend son hégémonie comme la peste par-delà les barrières culturelles qu’on chercherait en vain, la culture américaine ayant englobé le monde dans sa langue décadente qui n’a d’équivalent que les fast-foods aseptisés et sans goût qu’elle propage dans le béton des villes industrielles avec la rapidité d’une bactérie.
Ce qui pose problème pour Millet n’est pas la langue anglaise en soi, ni la littérature américaine dont Faulkner, James, Melville, Hemingway et d’autres encore ont prouvé qu’elle pouvait se hisser au faîte de la littérature occidentale, mais plutôt le délitement de la littérature qui s’opère par cette langue devenue hégémonique depuis un demi-siècle et qui, parce que langue de domination et de globalisation, a imposé une écriture standard, immédiatement traduisible en toutes langues comme seul paradigme possible aux auteurs postmodernes, faisant perdre toute spécificité aux différentes langues et cultures du monde. Ce qu’il déplore est qu’il n’y ait plus une littérature propre à la France, à l’Angleterre, à l’Allemagne ou à l’Italie mais une seule et même voix qui cherche à imiter la langue déstructurée et appauvrie de l’Amérique actuelle.
Plus qu’un essai ou qu’un pamphlet, ce recueil de réflexions apparaît au final comme un manifeste pour une littérature qui se réapproprie ses racines plutôt que de chercher coûte que coûte à se faire pardonner un passé qu’elle ne veut plus assumer, croyant que la modernité ne peut être que du côté de la pensée anglo-saxonne, alors que ce que la littérature américaine a de plus grand, c’est d’abord à l’Europe et à la France qu’elle le doit.
Membre du comité de lecture de la plus grande maison d’édition française, lecteur à la fois passionné et professionnel, Richard Millet sait de quoi il parle lorsqu’il s’attaque à ce qu’il définit comme la postlittérature. Il sait également de quoi il parle quand il compare sa pauvreté et son uniformisation à la grande littérature qu’a produite la langue française et qui fit d’elle pendant quelques siècles la langue des élites, de la diplomatie et de la culture.
Tout combat étant, devant être en même temps acte d’amour, la violence qu’il déploie à l’égard d’une littérature falsificatrice laisse cependant deviner en filigrane la passion qu’il voue à la vraie littérature, c’est-à-dire à celle qui cherche à s’élever au-dessus de la bassesse de l’homme, offrant la possibilité d’une rencontre des esprits dans une dimension verticale et non plus dans cette horizontalité qui agglutine les hommes en une masse informe et sans désir profond.
Si le plupart des réflexions de l’écrivain touchent dans le mille, on peut néanmoins regretter cette posture qu’adopte une fois de plus Millet, comme un désespoir d’apparat qui pourrait nous faire croire que les lecteurs et les écrivains sont une espèce en voie de disparition et qu’il n’y a plus rien à attendre de notre époque. Ce désespoir ne pouvant être aveuglement chez lui, qui sait aussi bien que nous combien rares sont les vrais écrivains dans chaque époque et combien ils se sont toujours sentis seuls, mis au ban de leur société, la plupart du temps reconnus après leur mort pour ce qu’ils étaient vraiment, nous sommes tentés d’en déduire que ce désespoir affecté n’est que l’orgueil d’un écrivain qui, pour aussi talentueux qu’il soit, n’est pas le seul ni le dernier aujourd’hui à savoir manier sa langue et à préférer Chateaubriand, Faulkner ou Melville aux centaines de romans sans lendemain qui paraissent chaque année.
En même temps que L’enfer du roman et comme pour prouver que le dramatique état des lieux de la littérature qu’il dresse ne l’empêche toutefois pas d’écrire, Millet publie Tarnac, un bref récit qui vient se placer dans sa longue reconstruction d’un monde à peu près disparu, entamée il y a presque trente ans.
Richard Millet, L’enfer du roman, réflexions sur la postlittérature, Gallimard, 276 pages.
Tarnac, récit, L’arpenteur, Gallimard, 83 pages.

Poster un Commentaire