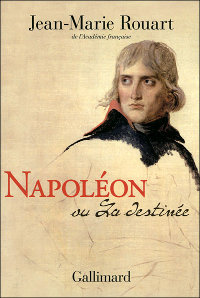 Nostalgie d’un temps où la grandeur et la gloire avaient encore cours ? D’un homme d’une autre trempe que nos aimables Corréziens qui ont davantage l’air des Bourbons effarouchés de la fin de l’Ancien régime et de la restauration que de l’homme du 18-Brumaire ? Nostalgie du petit homme de Neuilly, qui dans l’agitation et le mouvement perpétuel, avait quelque chose de Bonaparte, le génie et l’honneur en moins ? Non, celui-là ressemblerait plutôt à celui que Victor Hugo a châtié dans Les Châtiments, encore est-ce lui faire beaucoup d’honneur.
Nostalgie d’un temps où la grandeur et la gloire avaient encore cours ? D’un homme d’une autre trempe que nos aimables Corréziens qui ont davantage l’air des Bourbons effarouchés de la fin de l’Ancien régime et de la restauration que de l’homme du 18-Brumaire ? Nostalgie du petit homme de Neuilly, qui dans l’agitation et le mouvement perpétuel, avait quelque chose de Bonaparte, le génie et l’honneur en moins ? Non, celui-là ressemblerait plutôt à celui que Victor Hugo a châtié dans Les Châtiments, encore est-ce lui faire beaucoup d’honneur.
Quoi qu’il en soit, nos académiciens lorgnent ces temps-ci vers Napoléon Bonaparte, que ce soit Jean d’Ormesson avec sa Conversation imaginaire entre Napoléon et Cambacérès dont il se dit qu’elle rappelle les fameuses pièces de Brisville (Le souper, notamment) jouée en ce moment en théâtre Hébertot à Paris ou le Napoléon ou la destinée de Jean-Marie Rouart, dont il sera question ici.
Il faut dire qu’en ces temps de grande mollesse politique, où la seule volonté dont soient capables nos élus est d’augmenter les impôts à tout va et de mettre les peuples européens à genoux, au nom du sacro-saint euro, il n’est pas désagréable de se remémorer des périodes plus fastes, où l’on souffrait, sans doute, mais en se sentant vivre ; une époque où l’on était un peuple, non une sorte de magma agglutiné aux autres magmas d’Europe subissant le même joug, respirant le même air vicié. Une époque où la France était menée par un petit corse qui reprochait à raison aux Bourbons de n’avoir pas le courage de prendre la tête des armées chouannes ou vendéennes pour venir le défaire ; de faire plutôt appel aux armées ennemies pour envahir leur propre pays. Une époque qui, quoi qu’on en pense, a marqué notre pays durablement et profondément (il suffit de tenter de faire le compte des rues, avenues, monuments ou places de Paris qui se rapportent à Napoléon et à ses conquêtes ; de songer à tout ce qu’il a créé pour administrer la France : codes, préfets, départements, etc), si bien que de Gaulle à la fin de sa vie put dire à Malraux : « Pour nous, je comprends : il [Napoléon] affirme à la France qu’elle vaut mieux que ce qu’elle croit. Et nous, qu’avons-nous fait d’autre ? »
En effet, on peut succomber quelques instants à la nostalgie en repensant à Bonaparte s’élançant sur le Pont d’Arcole, envahissant la Russie, tentant le siège de Saint-Jean d’Acre pour prendre la route des Indes et devenir le nouvel Alexandre ; à Bonaparte s’entretenant avec Chateaubriand et Goethe auquel il fera modifier son Werther ; de même que, plus proche de nous, à de Gaulle s’entretenant avec Malraux, car il faut bien avouer que c’est tout de même autre chose que François Hollande recevant Bernard-Henri Lévy.
C’est donc de cela que parle, en filigrane, le livre de Jean-Marie Rouart. Et quand bien même il nous expliquerait que le Napoléon qui l’a toujours fasciné est ce Napoléon si souvent au bord du gouffre, si souvent près de tomber : inversant l’issue de la bataille au dernier moment comme à Marengo ; réchappant de son suicide en 1814 ; voulant se jeter sous la première voiture qui passait à 25 ans ou encore, désespéré des trahisons de Joséphine et prêt à se tuer pour une femme légère qui ne l’a jamais compris, alors même qu’il avait le monde à ses pieds ; malgré cela, Jean-Marie Rouart ne nous fera pas croire que Napoléon était un homme ordinaire, qu’il n’était pas ce « lieu de passage des forces de l’Histoire » ainsi que Rougemont définit le génie. « On ne tire pas sur un homme qui n’est rien et qui est tout. On ne tire pas sur un petit bourgeois qui est le rêve de 60 millions d’hommes. On tire sur un tyran, ou sur un roi, mais les fondateurs de religion sont réservés à d’autres catastrophes » écrit encore Rougemont, non au sujet de Bonaparte mais d’un autre génie fascinant qui a su hypnotiser les foules pour les mener à la catastrophe que l’on sait : Hitler.
Rougemont écrit encore : « Le Führer déclarait un jour qu’il ne craint pas les Ravaillac, parce que sa mission le protège. Il faut croire un homme qui dit cela. » C’est à peu de choses près ce que disait et pensait Napoléon (dont aucun projet d’assassinat ne put venir à bout), non pas qu’il faille mette les deux hommes sur le même plan, mais parce que ce genre d’hommes, heureusement rares (« Peut-être eût-il mieux valu pour le bonheur des peuples que lui [Rousseau] et moi n’eussions jamais existé », dit Napoléon) sont, d’une certaine manière, les jouets de l’Histoire, guidés par une étoile qu’eux seuls connaissent et qui les protège tant qu’elle scintille, aussi fous et déraisonnables soient leurs actes.
Il y a quelque chose de shakespearien en Napoléon Ier, quelque chose de ce Macbeth qui, protégé par les prophéties des sorcières, se sait invincible, tant que la forêt de Birnam ne marchera pas jusqu’à lui ou qu’un homme qui n’est pas né d’une femme ne viendra pas le tuer. (« Jusqu’à ce que Birnam monte vers Dunsinane / Je ne peux être pris de peur. Qu’est ce garçon Malcolm ? / N’est-il pas né d’une femme ? Or les esprits qui connaissent / Tout le mortel enchaînement ont prononcé pour moi ceci : / « Macbeth, ne crains rien, nul homme né d’une femme / Jamais ne pourra contre toi. » Alors fuyez, sires félons, / Mélangez-vous aux Epicuriens d’Angleterre : / Cet esprit qui me porte et le cœur que je porte / Ne fléchiront sous le doute et ne trembleront de peur. » V-3) Et même, dans l’incessante interrogation de Macbeth demandant si les enfants de Banquo règneront après lui, au lieu des siens propres (« Si c’est ainsi, / C’est pour la race de Banquo que j’aurai souillé mon âme »), on perçoit les angoisses de Bonaparte, épousant un « ventre » en la personne de Marie-Louise d’Autriche, hanté qu’il est pas la succession de son trône.
Et cette phrase de Macbeth, aussi lucide sur son destin qu’incapable de se dresser contre (comme Bonaparte, conscient que toutes les monarchies européennes conspireront jusqu’à ce qu’il tombe, lui, l’arriviste, enfant de la Révolution et régicide) : « Nul éperon / Pour exciter le flanc de mon vouloir, seulement / L’ambition voltigeante et dépassant son propre but, / Qui verse de l’autre côté, ». Et en Napoléon pas plus qu’en Macbeth, la volonté ne pourrait affranchir ce que l’un comme l’autre prennent pour le destin, car tous deux conscients, tergiversant, ruminant, ne se lancent dans leur épopée fatale que pleinement conscients que la chute sera aussi fracassante que l’ascension.
C’est au moment où il doute de son étoile que Napoléon flanche et s’enfonce, lui-même le sait. Car ces grands personnages, qui ont valeur d’exemple et de mythe, de littérature en somme, sont condamnés à la tragédie. Et c’est la grande force du livre de Jean-Marie Rouart que de nous faire vivre cette épopée napoléonienne comme une tragédie. N’y a-t-il pas quelque chose de shakespearien dans ces propos de l’Empereur : « J’ai commis une faute impardonnable. En épousant une Autrichienne, j’ai voulu unir le présent et le passé, les préjugés gothiques et les institutions de mon siècle. Je me suis trompé et je sens aujourd’hui l’étendue de mon erreur. Cela me coûtera peut-être mon trône, mais j’ensevelirai le monde sous mes ruines. »
Peut-être est-ce parce que la littérature ne sait plus aborder la tragédie ou l’épopée que le livre de Jean-Marie Rouart rencontre un vif succès aujourd’hui.
Jean-Marie Rouart, Napoléon ou la destinée, 347 pages, Gallimard.

Poster un Commentaire