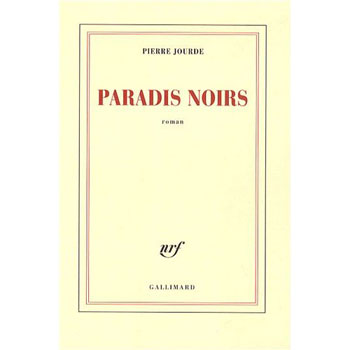 Un visage croisé dans le métro d’en face, une silhouette sur un quai de gare ont le pouvoir de réveiller les morts en nous, de faire ressurgir du fond de la mémoire des noms que l’on croyait oubliés.
Un visage croisé dans le métro d’en face, une silhouette sur un quai de gare ont le pouvoir de réveiller les morts en nous, de faire ressurgir du fond de la mémoire des noms que l’on croyait oubliés.
C’est ce qui arrive au narrateur de Paradis Noirs lorsqu’il croit reconnaître François dans une foule, un camarade de classe dont Boris, pourtant, lui assure qu’il est mort. Le visage de François, comme celui de Laure, sa meilleure amie noyée à l’âge de huit ans, semblent se recomposer sur d’autres visages, prendre les traits des vivants pour venir hanter sa mémoire, comme si les morts refusaient de mourir, de demeurer en paix là où ils sont. A moins que ce ne soient les vivants qui ne sachent pas être en paix avec eux-mêmes, travaillés par la mémoire, ressassant les méchancetés et les petites veuleries commises depuis l’enfance, toutes ces fautes et ces actes manqués qui sont peut-être les plus sûrs compagnons de la vieillesse.
Le visage de François replonge le narrateur dans leur enfance passée chez les frères, une institution qui alimentait les mondes mystérieux qu’on se crée à cet âge ; un univers fait d’obscurités et de silences éloquents d’où ils ne s’échappaient que pour plonger dans Clermont la ville sombre et dans la veille demeure de la grand-mère de François, où le silence encore et le noir prédominaient. Si l’enfance est un paradis perdu, il est sombre et secret ; à moins que les paradis noirs ne soient ces lieux que hantent les âmes des morts qui n’ont pas trouvé de réponses.
Dans Paradis Noirs finalement, c’est avec le souvenir de l’amour et de l’amitié que la culpabilité ressurgit, donnant sens aux trois vers de Baudelaire qui reviennent au long du récit comme une litanie, comme le remord ressassé jusque dans la tombe de n’avoir pas rendu l’amour que l’on devait :
La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse,
Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse,
Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs.
Pierre Jourde, Paradis Noirs, Gallimard, 266 pages, 18 euros.

Poster un Commentaire