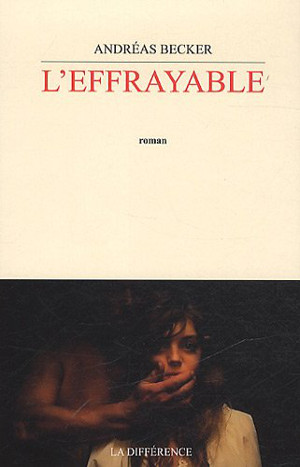 Dans L’effrayable, paru l’an passé, Andréas Becker révélait une profonde connaissance de la langue française, de sa grammaire et de sa syntaxe avec lesquelles il jouait pour révéler le déchirement intérieur, le dédoublement du personnage narrateur, sorte de mise en abyme du peuple allemand écartelé entre la folie et la rationalité, la barbarie et la civilisation, un peuple qui, à l’image du narrateur tour à tour homme effrayant et fillette effrayée se montrait terrifiant ou terrifiée, victorieux ou victime, en un mot effrayable.
Dans L’effrayable, paru l’an passé, Andréas Becker révélait une profonde connaissance de la langue française, de sa grammaire et de sa syntaxe avec lesquelles il jouait pour révéler le déchirement intérieur, le dédoublement du personnage narrateur, sorte de mise en abyme du peuple allemand écartelé entre la folie et la rationalité, la barbarie et la civilisation, un peuple qui, à l’image du narrateur tour à tour homme effrayant et fillette effrayée se montrait terrifiant ou terrifiée, victorieux ou victime, en un mot effrayable.
Pour mettre au jour les racines du mal, celui qui scinde l’in-dividu, qui en fait un dividu, un être divisé et par conséquent sans identité définie, produit des forces de l’histoire et de toutes les horreurs commises par ses semblables, il paraissait évident de remonter au nazisme, d’en passer par la guerre et le souvenir des atrocités les plus monstrueuses jamais commises au nom des hommes. De revenir à ce qui a soudain déclenché chez un des peuples les plus civilisés, les plus savants, les plus distingués, la barbarie la plus atroce, la folie la plus sanglante.
Ce narrateur double, avec sa langue désarticulée et désorientée, condensait à lui seul l’enfermement névrotique du peuple allemand à la fois coupable puis victime des pires maux du siècle et qui ne parvient ni à l’oublier ni à se le pardonner, trop conscient lui-même des horreurs commises en son nom, trop intelligent pour le méconnaître, trop civilisé pour ne pas sentir pleinement le rôle intolérable qu’il a joué, dès lors enfermé dans son histoire comme dans un cauchemar, sachant dès le début qu’il aurait un jour à rendre compte et à payer pour ce dont il était coupable et incapable dans le même temps de refréner son instinct, comme obéissant à un désir suicidaire et contagieux. Le dédoublement du narrateur prostré dans sa prison sans doute plus intérieure que physique peut être compris comme la mise en perspective du peuple tour à tour victorieux et vaincu puis scindé en son propre cœur, les Russes à l’Est, les Américains à l’Ouest. Double destin de l’Allemagne, double destin du narrateur qui se renvoie les différentes images de lui-même en miroir.
Mais le plus intéressant dans ce roman est le travail de Becker sur la langue comme révélateur de l’état de la civilisation. C’est le même travail qu’il a mené dans Nébuleuses, paru cet été. L’effondrement d’une civilisation commence toujours par celui de sa langue et plus une langue est construite, plus elle est réfléchie, plus sa grammaire est complexe, plus elle hisse la civilisation vers les sommets. Quand une langue dégringole, c’est un peuple qui s’écroule avec elle.
« Dans les temps j’ai eu-t-été une petite fille, une toute petite fillasse.
Je m’appelassais Angélique. »
Ainsi commence L’effrayable. Celle ou celui qui prétend avoir été une petite fille (on ne sait pas bien quel sexe choisir tant la confusion de son esprit est grande) craint la langue. Elle utilise un babil qu’on pourrait qualifier de presque subjonctif. Ses mots sont empreints de formes vieillottes et désuètes. Nous sommes dans le mode de l’hypothétique, de la supputation, du vague, du douteux. Nous comprenons que celle qui prétend avoir été une petite fille peut aussi ne l’avoir jamais été. Rien n’est moins sûr. Peut-être nous ment-on, peut-être nous a-t-on toujours menti, semble-t-elle dire. Peut-être n’a-t-elle jamais été une petite fille ? Peut-être ce qu’elle raconte de son histoire est-il vrai, peut-être ne l’est-il pas. Elle est sous la coupe de celui qu’elle nomme le dicteur, dont on ne sait s’il vit uniquement dans son esprit. Le dicteur s’exprime par le mode indicatif dont Grévisse nous dit qu’il fut aussi appelé jadis le mode affirmatif. L’indicatif est le mode du fait, contrairement au subjonctif qui n’affirme pas. Celui que le narrateur/narratrice nomme le dicteur est en grammaire la proposition principale, celle à laquelle est soumise la proposition subordonnée où l’on emploie le plus couramment le mode subjonctif. Ce dernier a beau dérailler, peiner, s’insurger, il finit par se soumettre. C’est la soumission à la règle, à la loi. L’ordre de la grammaire contre le chaos de l’inexactitude.
« je ne me rendrirai pas si facialementalement à votre normerie à vous, à votre courte-phraserie, à vos exactitudes, à vos exigences de bien-être et de bonheurterie. Eh ben, non, moi je criasserai et je vomiterai tant que j’aurassai encore de l’eau pestipulante dans mon basventre à moi, jusqu’au jour où vidassée, nettoyée, amputatée, directionnée et normée je serai enfin tout à fait morte pour vous. »
Il y a dans les deux romans d’Andréas Becker une lutte de la culture contre la sauvagerie, du surmoi contre le ça, pour reprendre les termes freudiens. La langue déchirée illustre la lutte constante que mène en l’homme la civilisation contre la pulsion instinctive et nous fait comprendre ceci : le retour à l’état sauvage nous guette constamment et peut être mis à nu par la langue. Et le XXe siècle a montré un visage de sauvagerie tel que l’homme civilisé n’en avait jamais connu. L’humanité moderne est divisée par ce retour en force de la sauvagerie, sa langue en reste blessée, son corps en est blessé, son âme aussi. Qui de l’instinct sauvage et immédiat ou de la construction intellectuelle civilisée gagnera la partie ?
D’une part, les différents modes grammaticaux sont le signe des désirs contradictoires qui coexistent en l’être humain et qui ne peuvent coexister en paix que s’ils sont ordonnés, que si le subjonctif (qui exprime l’éventualité, l’hypothèse, le sentiment, le souhait, le doute, le désir…) est assujetti à l’indicatif qui est le mode de l’énonciation et du fait, car lorsque le subjonctif tente de prévaloir il plonge l’individu dans la fiction, dans le mensonge et le déni, il fait dérailler sa langue et son esprit.
« Il eût valu que le subconditionnel du passé participé soit mon mode et mon temps à moi, voyez-vous, mon passe-temps à moi, mais ça, ça n’a jamais voulassé comme moi j’aurassais aimassé ; (…) Il eût mieux valu supportabiliser mes érudications, mes erratements, mes appriximitivements que de tirasser votre gueule d’académicien, vous connasseur de merde, remuasseur de mort, violasseur de mon seul avenirement, de mon destructionnement à moi, vous, piluleur de mon sang, de mon antre, de mon être, vous, corrigeur de ma fauterie, vous, tuasseur de mes libertissements. »
Tels sont les reproches que la soi-disant petite fille fait à son dicteur (sa conscience, peut-on imaginer), comme si vivre dans l’hypothétique, dans le doute ou le souhait pouvait sauver de quoi que ce soit. Comme si la règle, la grammaire, la connaissance, l’énonciation des faits étaient responsables des maux, étaient liberticides. Par le désordre qui règne dans son esprit, par son refus de la réalité, la confusion de ses propos, la soi-disant petite fille démontre à son insu le chaos qu’entraîne le refus des règles et de la correction. Quelle liberté autre qu’hypothétique y a-t-il à s’affranchir de la loi ?
Le subjonctif est le mode du mélancolique, de l’idéaliste. Vivre dans la fiction, c’est être dans le mensonge, dans le malheur, c’est refuser d’accepter la réalité, si terrible soit-elle. C’est au final ne pas vivre.
D’un autre côté, la déformation de la langue que met en œuvre Becker dans L’effrayable fait prendre conscience à quel point notre vision et notre explication du monde sont tributaires de notre langue et qu’une douleur autre, méconnue, cachée, est révélée par cette langue brisée, violée, qui est celle du narrateur enfermé en lui-même, dans la prison de son esprit et de ses mots. Que chaque histoire réinvente une langue et que l’utilisation personnelle de la langue dit beaucoup plus de l’individu profond que tous les discours. Enfin, sortir de la langue officielle, c’est sortir de cette langue médiatique et spectaculaire qui nous assène des chiffres, des dates et des faits à longueur de journée mais dit très peu, finalement, de l’expérience individuelle. C’est mettre en lumière la prééminence de la littérature sur toutes les sciences, en ce sens où elle seule s’intéresse à l’expérience individuelle, non à la masse indissociable, virtuelle et, au bout du compte, fictionnelle. Quel meilleur moyen que la forme romanesque pour sortir de la fiction ?
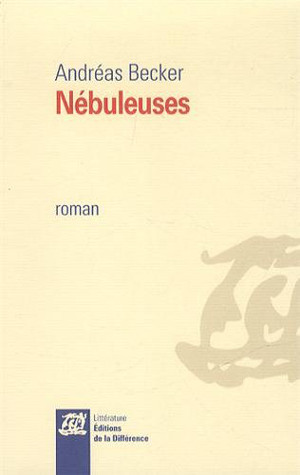 Dans Nébuleuses, qui paraît en cette rentrée, le jeu sur la langue est plus attaché à la ponctuation et à la syntaxe qu’à la grammaire et à la conjugaison. Les mots sont moins mis à mal mais révèlent autant de choses que le discours ne dit pas. C’est une fois de plus le combat entre la part instinctive, animale de l’être et la culture qui se mène. Que serait un être – une femme dans notre cas – sans conscience morale, sans inhibition, sans surmoi, pour garder l’acception freudienne ? Telle est la question que pose ce roman. C’est une personne entre parenthèses, comme le (moi) par lequel elle se désigne, une personne séparée des autres – eux – ainsi que le j’e par lequel elle se désigne encore le démontre. C’est une femme dont les désirs n’ont aucune barrière, qui n’a pas réellement de fantasme puisque rien ne l’empêche de réaliser ce qu’elle désire, dont le corps ne lui appartient pas vraiment et qui peut aussi bien être engrossée par son père que l’avoir seulement cru. C’est une femme, plus bête que femme, qui ne connaît nulle limite, nul interdit, et qui peut être le vecteur de l’inceste aussi bien que du parricide puisque même la première des lois sociales lui est inconnue.
Dans Nébuleuses, qui paraît en cette rentrée, le jeu sur la langue est plus attaché à la ponctuation et à la syntaxe qu’à la grammaire et à la conjugaison. Les mots sont moins mis à mal mais révèlent autant de choses que le discours ne dit pas. C’est une fois de plus le combat entre la part instinctive, animale de l’être et la culture qui se mène. Que serait un être – une femme dans notre cas – sans conscience morale, sans inhibition, sans surmoi, pour garder l’acception freudienne ? Telle est la question que pose ce roman. C’est une personne entre parenthèses, comme le (moi) par lequel elle se désigne, une personne séparée des autres – eux – ainsi que le j’e par lequel elle se désigne encore le démontre. C’est une femme dont les désirs n’ont aucune barrière, qui n’a pas réellement de fantasme puisque rien ne l’empêche de réaliser ce qu’elle désire, dont le corps ne lui appartient pas vraiment et qui peut aussi bien être engrossée par son père que l’avoir seulement cru. C’est une femme, plus bête que femme, qui ne connaît nulle limite, nul interdit, et qui peut être le vecteur de l’inceste aussi bien que du parricide puisque même la première des lois sociales lui est inconnue.
« j’ai rien fait avec mon fils – peut-être que j’aurais dû – peut-être que tout aurait mieux tourné – ou autrement du (moi)ns – avec mon fils – si j’avais su le punir – mais il a continué à manger des craies – sauf que maintenant que j’e lui en achetais de grandes quantités pour pas que ça se voie à l’école – et mon copain il était pas d’accord – mais j’avais aussi mOn amOur – qui voulait de plus en plus souvent me prendre dans des endroits insolites – et c’était pas facile – tout ça – la vie d’une jeune mère – et parfois j’e fatiguais beaucoup – c’est mon fils qui me fatiguait le plus – il gagnait sur (moi) – j’e voyais bien – il avait déjà gagné sur (moi) – il avait pas encore douze ans »
Cette famille dont parle la narratrice : un enfant obèse, non éduqué, qui mange tout ce qu’il trouve, se masturbe à tout bout de champ, fils de sa mère et de son grand-père, qui fait des choses à sa grand-mère ; un père inutile si ce n’est par son sexe ; une mère et une fille répétant les mêmes actes, à la sexualité désordonnée, débridée puis subitement éteinte, les sexes et les lignées qui se mélangent et s’abîment, c’est le retour à l’état primal de l’homme, au temps ante historique, d’avant la culture, d’avant la première loi. Un temps où, dès lors que la sexualité s’éteint, on dépérit, on est exclu, chassé du clan.
Ainsi le père et la fille sont-ils chassés par la mère et le fils, contraints de se réfugier dans les bois. Et ce sont, le père et la fille, les deux seuls êtres à avoir un embryon de conscience, contrairement au fils et à la mère, qui sont tels des bêtes, sans le moindre langage comprend-on, poussant seulement des cris et des geignements. Car la fille l’avoue, même si cela lui passe souvent par la tête, elle s’empêche de forniquer avec son père, bien qu’elle ne sache pas trop pourquoi. Dans ce monde, la sauvagerie chasse ce qu’il reste de culture, de loi. Elle exclut avec violence.
Le tour de force de Becker est de forger une langue en décomposition qui soit à la mesure du délitement intellectuel et culturel des êtres qu’elle fait parler. Car il n’y a pas de marqueur plus probant de l’état d’une culture que sa langue. Celle de Nébuleuses n’admet ni point ni majuscule, ce sont des bribes de phrases désordonnées, des bris de langage, nébuleuses de mots parmi lesquelles nous devons tenter de réorganiser le récit. La langue s’étiole comme le signe de la maladie qui ronge la civilisation.
« j’ai toujours rêvé d’être malade – enfin malade – infirme – invalide cogité-j’e – valétudinaire – égrotante cacochyme – mauvaise »
Tel est le début du récit de cette femme qui ne semble pas connaître de frontière entre le réel et l’imaginaire, dépourvue qu’elle est de parole organisée, donc de repère dans le temps et dans la mémoire, semblable à un enfant prêt à tout pour qu’on le remarque et l’admire mais qui n’a d’autre manière d’appréhension du monde que de prendre du plaisir ou de séduire. C’est un être sans complexe car sans conscience de l’autre, que Becker fait parler. Un être d’avant le complexe d’Œdipe. L’être sans éducation, sans morale, sans conscience qui nous attend peut-être, qui a certainement toujours coexisté en marge de la civilisation mais que la paupérisation de la langue est peut-être en train de multiplier. (Et l’on pense dans ces deux romans de Becker à L’énigme de Kaspar Hauser de Werner Herzog).
L’être commence par se croire au-dessus des lois qu’il a lentement forgées, il les refuse, puis finit par les oublier et replonge dans la plus pure animalité. Et nous en revenons au nazisme et aux horreurs de la guerre, aux viols massifs, aux expériences médicales, à l’eugénisme, aux expériences contre-nature qui font de toute loi une loi relative, donc dispensable. Le stade ultime de la civilisation est-il la sauvagerie ? La victoire du Ca sur le surmoi ?
« j’avais rien empêché – ni maman – ni papa – ni fiston – ni copain – ni mOn amOur – ni la fin du monde
j’étais la fin du monde – j’e l’avais nié pendant un certain temps
j’ai essayé
j’ai fait ce que j’ai pu
ça pas voulu
j’ai mal parlé de mOn amOur »
Andréas Becker, L’effrayable 255 pages, La Différence, 2012,
Nébuleuses, 173 pages, La Différence, 2013.

Poster un Commentaire