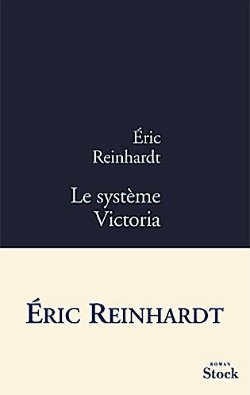 Le système Victoria d’Eric Reinhardt était dans la première sélection du Goncourt mais n’a pas passé la deuxième et c’est bien dommage car il s’agit sans doute d’un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire.
Le système Victoria d’Eric Reinhardt était dans la première sélection du Goncourt mais n’a pas passé la deuxième et c’est bien dommage car il s’agit sans doute d’un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire.
Roman à la fois très contemporain et intemporel, on peut le résumer en quelques mots : c’est une histoire d’amour passionnel entre Victoria de Winter et David Kolski. Le récit d’une passion, donc un récit tragique. Dès le premier chapitre, nous savons qu’il se terminera mal, reste à savoir pourquoi et comment.
La littérature occidentale envisage la passion amoureuse et l’adultère depuis ses origines, comme si la vraie passion ne pouvait se vivre qu’en une relation adultérine. L’Iliade d’Homère est déjà le récit d’une guerre provoquée par un amour adultérin entre Hélène et Pâris. Les récits d’amour courtois furent aussi des récits d’adultère. La princesse de Clèves puis les grands romans du XIXe siècle abordèrent presque tous la question de la passion amoureuse. Non pas le quotidien des couples honnêtes mais cet instant où la passion dévaste tout sur son passage, plaçant les individus face à la vie et à la mort.
Ce qu’il y a de très moderne dans le roman d’Eric Reinhardt, est l’inversion des rôles classiquement dévolus à l’homme et à la femme dans la littérature. Mis à part quelques cas isolés comme Une vieille maîtresse de Barbey d’Aurevilly ou la Vénus à la fourrure de Sacher-Masoch, c’est généralement l’homme qui domine la femme et lui impose une passion tragique. Mais Victoria de Winter est un prédateur fascinant et presque effrayant. On pourrait en conclure qu’au XXIe siècle les rôles sont inversés, que le prédateur sexuel et amoureux n’est plus l’homme mais la femme ; que c’est elle qui consomme le plaisir sexuel et que l’homme n’est plus qu’un produit destiné à la satisfaire. Mais ce serait une conclusion trop hâtive. Les choses sont toujours plus complexes et ce que l’on découvre des sentiments de Victoria à la fin du roman arrive comme un contrepoids à cette théorie. Victoria est une prédatrice mais n’est pas dénuée de sentiments, même si elle les laisse très peu transparaître. Cette femme est parfaitement maîtresse d’elle-même, d’où découle certainement la fascination qu’elle exerce sur David. Une femme sûre d’elle, de son pouvoir et de ses limites ; ce n’est que lorsqu’elle perd le contrôle que le drame survient.
Dans la société ultra-libérale de ce début de millénaire, Victoria incarne parfaitement son personnage de DRH monde d’une grande multinationale, sans doute parce qu’une femme résolue à tout peut aller plus loin qu’un homme ; parce qu’elle est capable d’étouffer tout sentimentalisme. David, lui, demeure un idéaliste qui ne parvient pas à s’accommoder d’un mode de fonctionnement qui lui paraît inhumain et son idéalisme ne lui rapporte qu’amertume et jalousie. Dans une configuration ultra-libérale, qu’elle soit professionnelle ou amoureuse, il ne peut que perdre. Il ne peut que se soumettre à celle qui refuse de céder au sentiment, à l’empathie, à celle pour qui le sexe est une lutte et pour qui la jouissance se gagne comme une hausse en bourse au prix d’un combat éreintant – tant pis pour ceux qui restent à la traîne. Le libéralisme poussé à l’extrême n’est rien d’autre qu’un retour à la sélection naturelle, à un monde sauvage où le faible ne peut que perdre.
Beaucoup ont dit qu’Eric Reinhardt écrivait dans la lignée de Michel Houellebecq. C’est vrai dans la mesure où il analyse la société libérale à travers les épiphénomènes que sont ses personnages. Son analyse est pourtant beaucoup plus fine car elle se place au-delà de la morale.
Les personnages de Houellebecq sont souvent névrosés et dépressifs, sa vision du monde est extrêmement pessimiste car il est dans une perspective morale du monde. Victoria, elle, agit au-delà de toute morale, par-delà bien et mal comme dirait Nietzsche. « Ce qui est fait par amour s’accomplit toujours par-delà bien et mal » pourrait être sa devise. Elle ne veut pas perdre de temps avec les états d’âme de David. Et l’on peut croire que ce qu’elle fait à la fin, elle le fait par amour pour David. Il arrive malheureusement un moment où elle perd la maîtrise de ses actes et ce n’est qu’à cause de cette défaillance que son histoire finit mal. La vraie question que pose ce roman et qui s’applique autant à la liaison de Victoria et David qu’à la société dans laquelle nous vivons est : sommes-nous assez forts pour dépasser toute morale ?
Car dans le fond, Eric Reinhardt ne juge ni l’un ni l’autre des deux personnages. Victoria est sublime car elle vit sa passion jusqu’au bout. Une des dernières paroles qu’elle adresse à David est : « S’il y a un truc que je supporte pas, c’est m’arrêter au beau milieu des choses ! » Quitte à se brûler les ailes. David, lui, semble perdu dans un monde qui va trop vite et qui le dépasse : « Qui a raison et qui a tort ? demande-t-il à Victoria. Personne, peut-être… Peut-être que le nombre de situations où il sera absurde de vouloir déterminer qui a raison, ou qui a tort, va aller en augmentant… C’est ça peut-être la définition de notre monde libéral, et c’est pourquoi tu l’incarnes si bien… » Le monde libéral est-il un monde amoral ? En ce sens, les moralisateurs sont-ils les gens de gauche comme David ? Un bref dialogue résume assez nettement la situation :
David : « – Ce qui est sûr c’est que vos vies de nantis sont vraiment favorables au plaisir : les vrais libertins d’aujourd’hui sont certainement dans ta mouvance. L’érotisme a changé d’opinion politique : je commence à en être convaincu.
Victoria : – C’est très exactement ce que je pense. Le sexe était du côté des hippies dans les années soixante-dix, il est du côté des DRH dans les années 2000 ! »
Mais en réalité David et Victoria ont une vision à court terme de l’histoire. Le libertinage a toujours été lié au libéralisme. Sade ne professe rien d’autre. Libéré de toute morale, le libertin ne rencontre aucun frein à son plaisir s’il a les moyens de les assouvir. C’est ce que dit Sade, c’est aussi ce que pense Victoria. Et le monde ultra libéral des années 2000 a été façonné par les hippies des années 70. En définitive le plaisir n’est pas une valeur de gauche ou de droite, la seule problématique est d’être capable d’assumer la fin de toute morale. Or aujourd’hui la droite politique l’assume de manière beaucoup plus décomplexée que la gauche. Est-ce pour un mieux, est-ce pour un pire ?
Il semble que l’auteur penche plutôt pour la deuxième solution dans le sens où il élargit le champ de la morale à l’éthique. La grande utopie de notre époque n’est-elle pas de croire que nous puissions vivre chacun pour soi, dans une lutte pour la domination ? – car celle-ci est sans aucun doute l’ultime jouissance des libéraux et des libertins.
Ce roman est passionnant car il aborde des questions cruciales sur la manière dont fonctionne notre monde, par le prisme de la passion amoureuse.
Le seul reproche que nous pourrions faire à son auteur – un reproche assez mince en comparaison de la très grande richesse de son livre – est d’employer avec abondance une syntaxe et un vocabulaire répandus par les ouvriers de la société ultra-libérale, un jargon assez répugnant formé par les DRH et les managers de tous poils, abondamment relayé par les journalistes économiques : « ce coma s’est solutionné ; comme je l’avais conjecturé ; il réceptionna la carte de crédit ; impacter, polémiquer, etc » autant de solécismes qui sont déjà une allégeance à la langue anglo-saxonne en tant que media parfaitement adapté à ce système de domination.
Ne pas céder à cette langue aussi laide que dictatoriale, ne serait-ce pas déjà une manière de résister à l’emprise de son idéologie ?
Eric Reinhardt, Le système Victoria, 522 pages, Stock.

Bizarre la littérature.
J’ai lu un roman qui a le même titre et j’ai eu l’impression d’une histoire interminable, répétitive, assez chic-choc et très bobo, avec des scènes de coucheries monotones, banales, lourdes et des dialogues grotesques.
Il faut être myope pour oser comparer cette médiocrité littéraire à Houellebecq et s’extasier sur : » Le sexe était du côté des hippies dans les années soixante-dix, il est du côté des DRH dans les années 2000 » et ne pas se rendre compte que c’est purement et simplement risible et assez nul. Et il y en a des dizaines sorties du même tonneau.
Ca se voudrait sulfureux c’est surtout très bête.
Quant au critique qui trouve que l’inversion des rôles et la domination par la femme sont révolutionnaires, il faut qu’il sorte de chez lui, aille au cinéma par exemple, et arrête la masturbation littéraire ; qu’il se rassure, le ridicule ne tue plus.
Bonjour,
ce qui me rassure en tout cas, c’est de constater qu’il existe des gens beaucoup plus critiques et méchants que moi. En ce qui concerne ma myopie, je pensais qu’elle était soignée, j’ai dépensé assez d’argent pour cela. En tout cas je persiste à voir dans le Système Victoria un livre beaucoup moins déprimant et beaucoup plus réaliste que ceux de Houellebecq. On n’est pas obligé d’écrire de manière réaliste, me direz-vous, mais c’est tout de même plus intéressant, à mon sens, que de dépeindre un monde de dépressifs impuissants qui vomissent tout le monde, à commencer par eux-mêmes. J’avoue que le dernier Houellebecq n’est pas de cette envergure, c’était juste un gentil navet calibré pour le Goncourt.
La Carte et le territoire ne m’a strictement rien appris, je l’ai d’ailleurs rapidement oublié tandis que le Système Victoria m’a beaucoup éclairé (eh oui, désolé d’être naïf et ridicule) et je ne suis pas le seul, à en juger par l’accueil qui a été fait à son auteur au festival des Correspondances de Manosque.
Quant à votre dernier paragraphe, il me semble de trop : pourquoi me dites-vous d’aller au cinéma alors que je parle de littérature ? Ceci dit, si vous m’envoyez un peu d’argent, j’irai volontiers au cinéma, ça me permettra de découvrir la vie et peut-être d’aspirer enfin à autre chose qu’un onanisme stérile. Merci d’avance.
La question n’est pas Houellebecq (qui quel que soient ses défauts est cnt coudées au dessus) mais l’appréciation que vous portez sur un roman qui ressemble (excusez la comparaison un peu ratée) à un de ces navets cinématographiques pseudo érotiques où des gens qui n’avaient rien à dire et trainaient leur nullité, qui vivaient dans des environnements luxueux, chics et tocs, comme dans ce roman que vous portez aux nues, avaient surtout le sexe triste et ennuyeux.
C’est surtout la vacuité des personnages du Système Victoria, érigée en principe moral par vous (!) et qui n’est rien d’autre qu’un mauvais roman, longuet répétitif, prévisible et fastidieux.
Quand même, il faut un certain aplomb pour oser écrire que la liberté amoureuse est aujourd’hui du côté des DRH et pour un « critique » s’extasier sur cette énomrité qui a sa place dans un bétisier littéraire.
Si, comme vous le dites, ce roman nous renseigne sur la manière dont fonctionne notre monde ( le votre probablement), c’est qu’il va très très mal.
Bien sûr, le monde va mal, vous ne l’aviez pas encore remarqué ? Ce monde n’est pas le mien, c’est le nôtre puisque nous vivons dirigés par des DRH, des politiciens, des managers qui pensent avant toute chose à prendre leur pied, non à s’occuper du bas peuple que nous sommes. C’est une constatation, je ne dis pas, l’auteur non plus, que c’est un bien. C’est un fait, que vous pouvez feindre d’ignorer, il est pourtant bien réel. Il est évidemment plus facile de mener une vie hédoniste quand on brasse des millions. Je ne trouve pas du tout que les personnages du roman soient vides, ni qu’ils aient le sexe triste et ennuyeux, c’est bien ce qui le différencie de Houellebecq. Et justement, je ne l’érige pas en principe moral car mon propos était de demander si ces gens-là étaient capables de s’affranchir de la morale. Laissons la morale au moralisateurs, ils sont déjà bien assez nombreux.