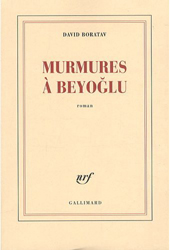 Le narrateur a perdu le sommeil et, dans ses insomnies quotidiennes, il repense à son passé, fait le grand écart entre sa vie londonienne, ses incursions à Paris et ses origines turques.
Le narrateur a perdu le sommeil et, dans ses insomnies quotidiennes, il repense à son passé, fait le grand écart entre sa vie londonienne, ses incursions à Paris et ses origines turques.
Lui revient également en mémoire un poème Zahir de son enfance dont la lecture est censée ôter le sommeil et qui lui a valu la première insomnie de sa vie, étant enfant.
Oscillant entre peinture du Londres d’aujourd’hui et souvenirs d’un Istanbul évanoui, Murmures à Beyoğlu est un livre sur la mémoire, mais un livre dont la narration trop lente, trop pesante, peine à porter l’attention du lecteur. C’est un livre savant, certainement, et d’ailleurs David Boratav est l’auteur d’articles et de dossiers passionnants qu’il publie notamment dans Chronic’art mais parfois trop de science nuit à la beauté de l’œuvre et c’est ce qui semble être le cas dans ce roman.
Trop de travail sur le texte, trop d’érudition en font au final un livre assez indigeste dont l’âme ne reviendrait hanter les pages qu’aux rares moments de relâchement, exactement comme le narrateur goûte des ersatz de sommeil à certains moments.
Ce qui prouve malheureusement encore une fois que les grands traducteurs et critiques littéraires ne font pas forcément les meilleurs romanciers.
David Boratav, Murmures à Beyoğlu, Gallimard, 354 pages.

Un anthropologue français débarque sur un campus universitaire américain pour « observer Franck Firth, le musicien, qui apprend à ses étudiants de Mills College comment on fait pour être ensemble quand on joue de la musique. »
Les élèves avec qui il va se lier sont appliqués, doués, cependant il semble leur manquer quelque chose pour arriver à être vraiment ensemble. Peut-être cette Mary dont d’étranges affiches placardées un peu partout sur le campus rappellent la disparition récente.
Sur fond d’anthropologie musicale contemporaine, une intrigue policière va se nouer autour de personnages bien étudiés et maîtrisés, dans une ambiance de suspicion, de silences troublants et d’intimidation.
Si l’écriture tombe parfois dans le stéréotype à force de vouloir coller aux personnages, l’ensemble est plutôt bien maîtrisé, les personnages existent et l’intrigue est originale.
Jocelyn Bonnerave, Nouveaux indiens, Le Seuil, 170 pages.
 Ce roman a déjà beaucoup d’adeptes et alimente largement les discussions sur le web. Il ne laisse pas insensible et c’est déjà une bonne chose.
Ce roman a déjà beaucoup d’adeptes et alimente largement les discussions sur le web. Il ne laisse pas insensible et c’est déjà une bonne chose.
L’histoire est celle d’une poignée de personnes condamnées à vivre dans un nulle part d’où ils ne peuvent s’échapper. Comme le résume si bien le narrateur « On est la lie de l’humanité. Des fions dans le trou du cul du monde. » Alors, ils se retrouvent au bar pour picoler puisque c’est la seule chose qu’ils aient à faire, en attendant que leur vie passe. Jusqu’à ce qu’un jour leur quotidien paisible et inutile bascule. Estelle Nollet parvient avec brio à dresser les portraits de personnages déchus qui ont reclus tout espoir de vivre au tréfonds d’eux-mêmes avec l’aide de la boisson : des ivrognes au passé plus ou moins honteux, un simplet qui creuse des trous, le narrateur qui creuse les consciences pour trouver une issue et ceux qui ne creusent plus que leur propre caveau. Dans une langue drôle et familière qui n’est pas sans rappeler celle d’Olivier Maulin, en plus forcée et surfaite cependant, Estelle Nollet prouve qu’un premier roman peut être davantage qu’une promesse encourageante et que la langue des ivrognes n’est pas forcément l’apanage des hommes.
Estelle Nollet, On ne boit pas les rats-kangourous, Albin Michel, 328 page.

Poster un Commentaire