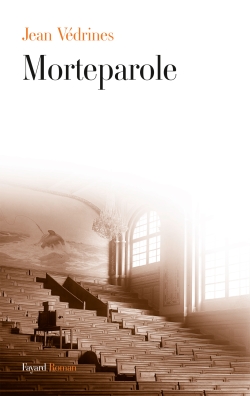
Jean Védrines est en colère – comment ne pas l’être aujourd’hui ?
Cela avait commencé avec son précédent roman, La belle étoile, bien que l’on puisse trouver les prémices d’une juste colère dans l’antépénultième roman, L’Italie la nuit. Mais cette fois il semble plus fâché qu’à l’accoutumée.
Fâché contre les aberrations administratives qui soumettent et infantilisent et ridiculisent les professeurs.
Fâché contre la soumission de tout un chacun à l’ordre crétin qui s’est établi.
Fâché contre le dépeçage de la langue, la fin du mystère qu’a longtemps incarné la littérature, la haine de la poésie, de l’âme, de l’aura de l’être. Fâché que l’on force les professeurs à enseigner à leurs élèves – des enfants – une langue qui n’est que technique, qui n’est que scalpel à découper du texte, à trifouiller les entrailles littéraires, à emplir de dégoût ceux qui la manient : une langue morte, une morteparole.
Dans ce très beau roman, dont la langue étonne à chaque mot, à chaque phrase et qui berce le lecteur d’une musique unique dont seul Jean Védrines a le secret, c’est la jeunesse de Giovan et Paul, que nous avons appris à connaître dans les romans précédents, qui nous est contée. La jeunesse, et donc la dépossession des rêves et des illusions : le rêve de la révolution prolétarienne pour Giovan l’italien, le métèque, le pouilleux. Le rêve des belles études et de l’enseignement pour Paul, le premier de classe, le bon élève, bon travailleur, normalien et amoureux de sa langue, de l’antiquité.
Mais, semble nous dire l’écrivain, quelle que soit la situation sociale et professionnelle aujourd’hui, que l’on soit employé, ouvrier, professeur, donneur de leçons, tous nous sommes écrasés, broyés, commandés à tout bout de champ et humiliés par les petits chefs, les kapos, les collabos.
Et il faut dire que cette juste colère souffle à Jean Védrines des passages particulièrement savoureux, tels que celui où Giovan l’immigré, l’Abdelkader des Pouilles comme il se surnomme, est convoqué en conseil de discipline et défendu in extremis par la Vestale, son professeur de français qui s’insurge comme une belle révolutionnaire :
« Mais je dis qu’ils n’étaient guère nombreux à avoir la pitié, à pouvoir pardonner mes manquements de pauvre, d’idiot, parce que beaucoup de mes juges se sont bien accommodés, dans les années qui ont suivi, des myriades de gosses de riches fainéants, nullards et morgueux qui n’ont jamais été fichus dehors, eux, ont hanté les lycées, en rentiers arrogants et traînards, et ont fini dans le pire de notre temps, les écoles à commerceux, les milliers de fabriques à petits chefs illettrés, ces machines à produire une langue technique et fruste, aigre et mauvaise, et qui ont tué la parole, eux tous, commis le crime totalitaire, imposé ce Reich de la vente et du produit dont ils sont les galonnés, les kapos. »
Jean Védrines porte haut la voix des pauvres, des cancres, des écrasés, des rêveurs, des dominés et il le fait dans la vérité de la langue qui est sans nul doute l’arme la plus redoutable qu’il reste aux pauvres pour combattre les puissants.
Et il est assez rare qu’un écrivain sache si bien porter la voix du peuple et le fasse sans apitoiement, sans morgue, sans mépris de classe, sans fausse pitié, mais comme tout naturellement et avec humilité et courage, pour que ses livres soient lus et loués.
Jean Védrines, Morteparole, Fayard, 248 pages

Poster un Commentaire